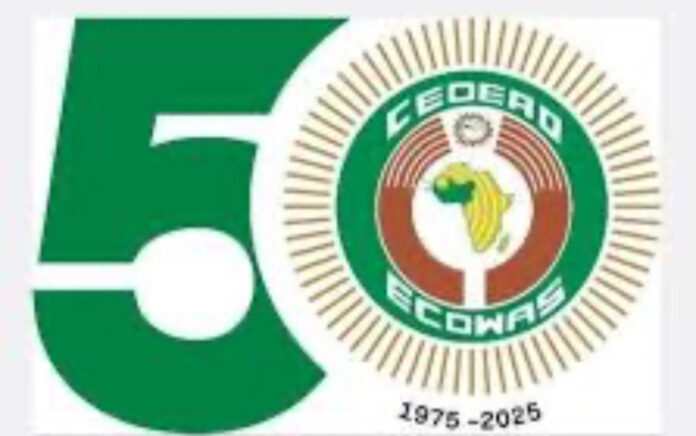La CEDEAO célèbre son jubilé d’or dans un contexte marqué par des défis complexes/ CEDEAO
Cette année, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) célèbre son cinquantième anniversaire. Les festivités débutent ce mardi 22 avril à Accra, marquant un jalon important pour une organisation fondée le 28 mai 1975 à Lagos. À l’origine, la Cédéao avait pour mission de favoriser la coopération et l’intégration économiques des États ouest-africains. Aujourd’hui, bien que quinze États en fassent partie, trois d’entre eux — le Mali, le Burkina Faso et le Niger — ont annoncé leur retrait, soulevant des questions sur l’avenir de l’organisation.
Une organisation à la croisée des chemins
Critiquée et fragilisée, la Cédéao se trouve à un tournant décisif. Malgré ses efforts passés pour s’adapter aux défis régionaux, l’organisation est confrontée à une multitude de crises. En 1990, face au conflit au Libéria, elle a créé l’Ecomog, une force d’intervention militaire. Neuf ans plus tard, elle a élargi son champ d’action en adoptant un protocole sur la paix et la sécurité, suivi en 2001 par un autre protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Cependant, la multiplication des conflits et l’émergence de l’extrémisme violent ont mis à mal ces avancées.
Amandine Gnanguénon, chercheuse senior à l’Africa Policy Research Institute de Berlin, souligne que la Cédéao n’était pas préparée à faire face à ces défis. « Il a été difficile de mettre en place des dispositifs d’intervention tout en assurant la prévention », explique-t-elle. L’organisation a perdu le contrôle de son agenda au profit de nouvelles structures comme le G5 Sahel et l’initiative d’Accra. Avec la création de l’Alliance des États sahéliens (AES), la survie de la Cédéao est désormais en jeu.
Pour continuer à exister et faire entendre sa voix, la Cédéao doit se réformer en profondeur. Cela implique un retour aux principes d’intégration économique et politique qui ont guidé sa création. « Il est essentiel de donner plus de visibilité sur ses actions et de communiquer efficacement avec les populations », ajoute Gnanguénon. Ces changements dépendent en grande partie de la volonté des chefs d’État, qui détiennent le pouvoir d’initier des réformes à travers la conférence des présidents.
Avancées et échecs économiques
À ses débuts, la Cédéao avait pour objectif principal de promouvoir l’intégration économique. Bien qu’il y ait eu des avancées, de nombreux objectifs, tels que la création d’un marché commun ouest-africain, n’ont pas été atteints. Parmi les succès notables, on trouve la libre circulation des personnes et des biens. Grâce à la carte d’identité Cédéao, les citoyens peuvent accéder à des emplois dans tous les pays de la région sans avoir besoin d’un permis de séjour, à l’exception des emplois publics. Cette réalisation est souvent citée comme un modèle de réussite par le chercheur sénégalais Pape Ibrahima Kane, qui mentionne également l’harmonisation des droits de douane grâce à une taxe communautaire.
Cependant, les projets d’infrastructures, notamment les corridors de transport, ont connu des résultats mitigés. Actuellement, seul le corridor entre Abidjan et Lagos est opérationnel, tandis que d’autres réseaux routiers ne répondent pas aux attentes. Le commerce intrarégional stagne à moins de 15 % du total des exportations, chaque pays continuant à agir de manière isolée. Les économies des États membres se sont révélées peu complémentaires, et la promesse d’une monnaie unique a été maintes fois reportée.
Les disparités de ressources entre les pays, le manque de leadership — le Nigeria, censé être le moteur de la Cédéao, étant embourbé dans ses propres problèmes politiques, économiques et sécuritaires — ainsi que les crises récurrentes, comme le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso, entravent la réalisation des ambitions de l’organisation depuis 1975.
En conclusion, alors que la Cédéao célèbre ses 50 ans, elle se trouve à un carrefour crucial. Pour redéfinir son rôle et son efficacité dans la région, elle devra s’engager dans une réforme significative et renouer avec ses objectifs initiaux d’intégration et de coopération. Les défis sont nombreux, mais l’avenir de l’organisation dépendra de sa capacité à s’adapter et à répondre aux besoins de ses États membres et de leurs populations.
Thom Biakpa